
billets d'humeur, notes de lecture, réactions de spectatrice...
12 Décembre 2018


Le narrateur, François Seurel, vit avec ses parents instituteurs. Un dimanche de 189… ils reçoivent la visite d’une femme et de son fils, Augustin Meaulnes.
[…]
Ils étaient venus tous les deux, en voiture, de La Ferté-d’Angillon, à quatorze kilomètres de Sainte-Agathe. Veuve — et fort riche, à ce qu’elle nous fit comprendre — elle avait perdu le cadet de ses deux enfants, Antoine, qui était mort un soir au retour de l’école, pour s’être baigné avec son frère dans un étang malsain. Elle avait décidé de mettre l’aîné, Augustin, en pension chez nous pour qu’il pût suivre le Cours Supérieur.
Et aussitôt elle fit l’éloge de ce pensionnaire qu’elle nous amenait. Je ne reconnaissais plus la femme aux cheveux gris, que j’avais vue courbée devant la porte, une minute auparavant, avec cet air suppliant et hagard de poule qui aurait perdu l’oiseau sauvage de sa couvée.
Ce qu’elle contait de son fils avec admiration était fort surprenant : il aimait à lui faire plaisir, et parfois il suivait le bord de la rivière, jambes nues, pendant des kilomètres, pour lui rapporter des œufs de poules d’eau, de canards sauvages, perdus dans les ajoncs… Il tendait aussi des nasses… L’autre nuit, il avait découvert dans le bois une faisane prise au collet…
Moi qui n’osais plus rentrer à la maison quand j’avais un accroc à ma blouse, je regardais Millie avec étonnement.
Mais ma mère n’écoutait plus. Elle fit même signe à la dame de se taire ; et, déposant avec précaution son « nid » sur la table, elle se leva silencieusement comme pour aller surprendre quelqu’un…
Au-dessus de nous, en effet, dans un réduit où s’entassaient les pièces d’artifice noircies du dernier Quatorze Juillet, un pas inconnu, assuré, allait et venait, ébranlant le plafond, traversait les immenses greniers ténébreux du premier étage, et se perdait enfin vers les chambres d’adjoints abandonnées où l’on mettait sécher le tilleul et mûrir les pommes.
— Déjà, tout à l’heure, j’avais entendu ce bruit dans les chambres du bas, dit Millie à mi-voix, et je croyais que c’était toi, François, qui étais rentré…
Personne ne répondit. Nous étions debout tous les trois, le cœur battant, lorsque la porte des greniers qui donnait sur l’escalier de la cuisine s’ouvrit ; quelqu’un descendit les marches, traversa la cuisine, et se présenta dans l’entrée obscure de la salle à manger.
— C’est toi, Augustin ? dit la dame.
C’était un grand garçon de dix-sept ans environ. Je ne vis d’abord de lui, dans la nuit tombante, que son chapeau de feutre paysan coiffé en arrière et sa blouse noire sanglée d’une ceinture comme en portent les écoliers. Je pus distinguer aussi qu’il souriait…
Il m’aperçut, et, avant que personne eût pu lui demander aucune explication :
— Viens-tu dans la cour ? dit-il.
J’hésitai une seconde. Puis, comme Millie ne me retenait pas, je pris ma casquette et j’allai vers lui. Nous sortîmes par la porte de la cuisine et nous allâmes au préau, que l’obscurité envahissait déjà. À la lueur de la fin du jour, je regardais, en marchant, sa face anguleuse au nez droit, à la lèvre duvetée.
— Tiens, dit-il, j’ai trouvé ça dans ton grenier. Tu n’y avais donc jamais regardé ?
Il tenait à la main une petite roue en bois noirci ; un cordon de fusées déchiquetées courait tout autour ; ç’avait dû être le soleil ou la lune au feu d’artifice du Quatorze Juillet.
— Il y en a deux qui ne sont pas parties : nous allons toujours les allumer, dit-il d’un ton tranquille et de l’air de quelqu’un qui espère bien trouver mieux par la suite.

INCIPIT DE LA GRANDE MAISON * (1952)
- Un peu de ce que tu manges !
Omar se planta devant Rachid Berri.
Il n’était pas le seul ; un faisceau de mains tendues s’était formé et chacune quémandait sa part. Rachid détacha un petit bout de pain qu’il déposa dans la paume la plus proche.
- Et moi ! Et moi !
Les voix s’élevèrent en une prière ; Rachid protesta. Toutes ces mains tentèrent de lui arracher son croûton.
- Moi ! Moi !
- Moi, tu ne m’en as pas donné !
- C’est Halim qui a tout pris.
- Non, ce n’est pas moi !
Harcelé de tous côtés, le gosse s’enfuit à toutes jambes, la meute hurlante sur ses talons. Estimant qu’il n’y avait rien à en tirer, Omar abandonna la poursuite.
Il s’en fut ailleurs. D’autres enfants grignotaient tranquillement leur quignon. Il louvoya longtemps entre les groupes. Puis, d’un trait, il fondit dans la cohue, arracha son pain à un costaud. Il courut ensuite se perdre au centre de l’école, où il fut aspiré par le tourbillon des jeux et des cris. La victime ne sut que brailler sur place.
Il y avait des élèves qu’il rançonnait, quotidiennement. Il exigeait d’eux sa part, et s’ils ne s’exécutaient pas sur-le-champ ils ramassaient souvent des volées. Dociles, ceux-là partageaient leur goûter et lui tendaient les deux moitiés pour qu’il en prélevât une à son choix.
L’un d’eux se cachait-il pendant toute une récréation, il ne s’obstinait guère dans sa dissimulation. Il venait guetter Omar soit à la sortie de l’école, soit à une autre récréation. Du plus loin qu’il l’apercevait, il commençait à pleurer. Il recevait sa correction et finissait par remettre un goûter entier à Omar.
Mais les plus rusés dévoraient leur pain en classe.
- Je n’ai rien apporté aujourd’hui, disaient-ils.
L’enfant retournait ses poches. Omar faisait main basse sur tout ce qu’il trouvait en sa possession.
- Alors, tu l’as donné à un autre pour le cacher ?
- Non, je le jure.
- Ne mens pas !
- Je le jure.
- Ne viens pas me demander de te défendre, hein !
- Je te jure que je t’apporterai demain un gros morceau.
D’un geste, l’enfant montrait les dimensions du pain qu’il promettait. Omar lui jetait la calotte par terre, la piétinait, pendant que le coupable poussait des plaintes de chien molesté.
Il protégeait ainsi ceux que les grands élèves tyrannisaient ; la part qu’il prenait n’était que son salaire. Ses dix ans le plaçaient entre les gaillards du Cours Supérieur, dont la moustache noircissait, et les morveux du Cours Préparatoire. Les grands, pour se venger, s’attaquaient à lui, mais n’obtenaient rien, Omar n’apportait jamais de pain. Lui et ses adversaires sortaient de ces combats le nez et les dents en sang, leurs sordides habits effilochés un peu plus. C’était tout.
A Dar-Sbitar, Omar se procurait du pain d’une autre façon. Yamina, une petite femme aux jolis traits, revenait chaque matin du marché avec un plein couffin. Elle priait souvent Omar de lui faire de petites commissions. Il lui achetait du charbon, remplissait son seau d’eau à la fontaine publique, lui portait le pain au four… Yamina le récompensait à son retour en lui donnant une tranche de pain avec un fruit ou un piment grillé, - de temps en temps, un morceau de viande ou une sardine frite. Quelquefois, après déjeuner ou dîner, elle l’appelait. Quand l’enfant soulevait le rideau, - à l’heure du repas, chaque famille baissait le sien, - elle lui disait d’entrer, apportait un plat où elle gardait quelque chose de bon, cassait la miche ronde et blanche et plaçait le tout devant lui.
- Maintenant mange, mon garçon.
Elle le laissait et vaquait dans la pièce. Yamina ne lui offrait que des reliefs, mais propres ; les plus difficiles n’auraient rien trouvé à y redire. La veuve ne le traitait pas comme un chien ; et cela lui plaisait. Ne pas être humilié. Omar ne savait pas où se mettre devant tant d’égards. Il fallait que chaque fois Yamina le pressât pour l’encourager à toucher aux aliments.
Un petit, un mioche de rien du tout, aux grands yeux sombres comme de l’anthracite, au visage pâle et inquiet, se tenait à l’écart. Omar l’observait : debout contre un pilier du préau, les mains derrière le dos, il ne jouait pas, celui-là. Omar fit le tour de la cour, surgit de derrière un platane, et laissa tomber à ses pieds ce qui lui restait d’un croûton. Il fit mine de ne point s’en apercevoir et continua de courir. Arrivé à bonne distance, il s’arrêta, et l’épia. Il le vit de loin fixer le bout de pain, puis s’en saisir d’un geste furtif et mordre dedans.
L’enfant s’était ramassé sur lui-même. Son torse exigu était emmailloté dans une veste de coutil d’été kaki ; ses jambes frêles sortaient des tuyaux d’une trop longue culotte. Une joie angélique éclairait ses traits : il se retourna face au pilier. Omar ne comprenait pas ce qui lui arrivait, sa gorge se contractait. Il courut dans la grande cour de l’école, et sanglota.
* Ce roman inaugure la trilogie réaliste dite "algérienne", complétée par L'Incendie (1954) et Le métier à tisser (1957). M. Dib met en scène le même personnage, un enfant prénommé Omar, que nous voyons grandir (de l'âge de dix ans à celui de quatorze ans). Le parcours de ce protagoniste nous permet de découvrir tout un monde accablé par la misère et l'oppression coloniale : le contexte historique est celui de la Seconde guerre mondiale (de 1939 à 1942).


L’ENFANT (incipit) DE JULES VALLES
L'Enfant est un roman de Jules Vallès, premier volet de la trilogie des Mémoires d'un révolté, qui paraît pour la première fois en feuilletons dans la revue Le Siècle du 28 juin au 5 août 1878 sous le pseudonyme La Chaussade. Cette aventure de Jacques Vingtras, publiée en volume chez Georges Charpentier en 1879, sera suivie des deux autres épisodes de la trilogie : Le Bachelier et L'Insurgé. Il s'agit d'un roman autobiographique (Jules Vallès // Jacques Vingtras) dans la mesure où l'auteur crée une fiction en s'inspirant de nombre d'anecdotes personnelles et d'observations faites au fur et à mesure de l'enfance, à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte.
Ai-je été nourri par ma mère ? Est-ce une paysanne qui m'a donné son lait ? Je n'en sais rien. Quel que soit le sein que j'ai mordu, je ne me rappelle pas une caresse du temps où j'étais tout petit ; je n'ai pas été dorloté, tapoté, baisoté ; j'ai été beaucoup fouetté.
Ma mère dit qu'il ne faut pas gâter les enfants, et elle me fouette tous les matins ; quand elle n'a pas le temps le matin, c'est pour midi, rarement plus tard que quatre heures.
Mlle Balandreau m'y met du suif.
C'est une bonne vieille fille de cinquante ans. Elle demeure au-dessous de nous. D'abord elle était contente: comme elle n'a pas d'horloge, ça lui donnait l'heure. "Vlin ! Vlan! Zon ! Zon ! - voilà le petit Chose qu'on fouette; il est temps de faire mon café au lait."
Mais un jour que j'avais levé mon pan, parce que ça me cuisait trop, et que je prenais l'air entre deux portes, elle m'a vu; mon derrière lui a fait pitié.
Elle voulait d'abord le montrer à tout le monde, ameuter les voisins autour; mais elle a pensé que ce n'était par le moyen de le sauver, et elle a inventé autre chose.
Lorsqu'elle entend ma mère me dire : " Jacques, je vais te fouetter !"
- Madame Vingtras, ne vous donnez pas la peine, je vais faire ça pour vous.
- Oh ! Chère demoiselle, vous êtes trop bonne !"
Mlle Balandreau m'emmène ; mais, au lieu de me fouetter, elle frappe dans ses mains ; moi, je crie. Ma mère remercie, le soir, sa remplaçante.
"A votre service", répond la brave fille, en me glissant un bonbon en cachette.
Mon premier souvenir date donc d'une fessée. Mon second est plein d'étonnement et de larmes.
C'est au coin d'un feu de fagots, sous le manteau d'une vieille cheminée; ma mère tricote dans un coin ; une cousine à moi, qui sert de bonne dans la maison pauvre, range, sur des planches rongées, quelques assiettes de grosse faïence avec des coqs à crête rouge, et à queue bleue.
Mon père a un couteau à la main et taille un morceau de sapin; les copeaux tombent jaunes et soyeux comme des brins de rubans. Il me fait un chariot avec des languettes de bois frais. Les roues sont déjà taillées; ce sont des ronds de pommes de terre avec leur cercle de peau brune qui imite le fer... Le chariot va être fini ; j'attends tout ému et les yeux grands ouverts, quand mon père pousse un cri et lève sa main pleine de sang. Il s'est enfoncé le couteau dans le doigt. Je deviens tout pâle et je m'avance vers lui; un coup violent m'arrête; c'est ma mère qui me l'a donné, l'écume aux lèvres, les poings crispés.
"C'est ta faute si ton père s'est fait mal !"
Et elle me chasse sur l'escalier noir, en me cognant encore le front contre la porte.
Je crie, je demande grâce, et j'appelle mon père: je vois, avec ma terreur d'enfant, sa main qui pend toute hachée; c'est moi qui en suis cause! Pourquoi ne me laisse-t-on pas entrer pour savoir? On me battra après si l'on veut. Je crie, on ne me répond pas. J'entends qu'on remue des carafes, qu'on ouvre un tiroir; on met des compresses.
"Ce n'est rien", vient me dire ma cousine, en pliant une bande de linge tachée de rouge.
Je sanglote, j'étouffe : ma mère reparaît et me pousse dans le cabinet où je couche, où j'ai peur tous les soirs.
Je puis avoir cinq ans et me crois un parricide.
Ce n'est pas ma faute, pourtant !
Est-ce que j'ai forcé mon père à faire ce chariot ? Est-ce que je n'aurais pas mieux aimé saigner, moi, et qu'il n'eût point mal ?
Oui - et je m'égratigne les mains pour avoir mal aussi.
C'est que maman aime tant mon père! Voilà pourquoi elle s'est emportée.
On me fait apprendre à lire dans un livre où il y a écrit, en grosses lettres, qu'il faut obéir à ses père et mère: ma mère a bien fait de me battre.

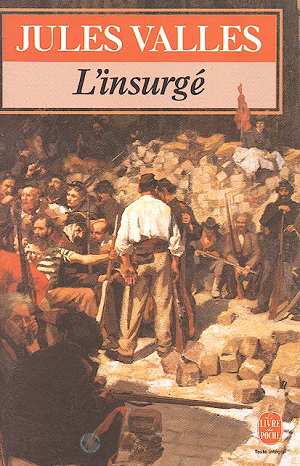
SUITE DE LA TRILOGIE (L'Enfant, Le Bachelier et L'Insurgé)

Romain GARY
L'incipit de La vie devant soi*
De « La première chose que je peux vous dire » à « Est-ce qu’on peut vivre sans amour ? »
La première chose que je peux vous dire c'est qu'on habitait au sixième à pied et que pour Madame Rosa, avec tous ces kilos qu'elle portait sur elle et seulement deux jambes, c'était une vraie source de vie quotidienne, avec tous les soucis et les peines. Elle nous le rappelait chaque fois qu'elle ne se plaignait pas d'autre part, car elle était également juive. Sa santé n'était pas bonne non plus et je peux vous dire aussi dès le début que c'était une femme qui aurait mérité un ascenseur. Je devais avoir trois ans quand j'ai vu Madame Rosa pour la première fois. Avant, on n'a pas de mémoire et on vit dans l'ignorance. J'ai cessé d'ignorer à l'âge de trois ou quatre ans et parfois ça me manque. Il y avait beaucoup d'autres Juifs, Arabes et Noirs à Belleville, mais Madame Rosa était obligée de grimper les six étages, seule. Elle disait qu'un jour elle allait mourir dans l'escalier, et tous les mômes se mettaient à pleurer parce que c'est ce qu'on fait toujours quand quelqu'un meurt. On était tantôt six ou sept tantôt même plus là- dedans.
Au début, je ne savais pas que Madame Rosa s'occupait de moi seulement pour toucher un mandat à la fin du mois. Quand je l'ai appris, j'avais déjà six ou sept ans et ça m'a fait un coup de savoir que j'étais payé. Je croyais que Madame Rosa m'aimait pour rien et qu'on était quelqu'un l'un pour l'autre. J'en ai pleuré toute une nuit et c'était mon premier grand chagrin. Madame Rosa a bien vu que j'étais triste et elle m'a expliqué que la famille ça ne veut rien dire et qu'il y en a même qui partent en vacances en abandonnant leurs chiens attachés à des arbres et que chaque année il y a trois mille chiens qui meurent ainsi privés de l'affection des siens. Elle m'a pris sur ses genoux et elle m'a juré que j'étais ce qu'elle avait de plus cher au monde mais j'ai tout de suite pensé au mandat et je suis parti en pleurant.
Je suis descendu au café de Monsieur Driss en bas et je m'assis en face de Monsieur
Hamil qui était marchand de tapis ambulant en France et qui a tout vu. Monsieur Hamil a de beaux yeux qui font du bien autour de lui. Il était déjà très vieux quand je l'ai connu et depuis il n'a fait que vieillir.
- Monsieur Hamil, pourquoi vous avez toujours le sourire ?
- Je remercie ainsi Dieu chaque jour pour ma bonne mémoire, mon petit Momo. Je m'appelle Mohammed mais tout le monde m'appelle Momo pour faire plus petit.
- Il y a soixante ans, quand j'étais jeune, j'ai rencontré une jeune femme qui m'a aimé et que j'ai aimée aussi. Ça a duré huit mois, après, elle a changé de maison, et je m'en souviens encore, soixante ans après. Je lui disais : je ne t'oublierai pas. Les années passaient, je ne l'oubliais pas. J'avais parfois peur car j'avais encore beaucoup de vie devant moi et quelle parole pouvais-je donner à moi-même, moi, pauvre homme, alors que c'est Dieu qui tient la gomme à effacer ? Mais maintenant, je suis tranquille. Je ne vais pas oublier Djamila. Il me reste très peu de temps, je vais mourir avant.
J'ai pensé à Madame Rosa, j'ai hésité un peu et puis j'ai demandé :
- Monsieur Hamil, est-ce qu'on peut vivre sans amour ?
Il n'a pas répondu. Il but un peu de thé de menthe qui est bon pour la santé.
Monsieur Hamil portait toujours une jellaba grise, depuis quelque temps, pour ne pas être surpris en veston s'il était appelé. Il m'a regardé et a observé le silence. Il devait penser que j'étais encore interdit aux mineurs et qu'il y avait des choses que je ne devais pas savoir. En ce moment je devais avoir sept ans ou peut- être huit, je ne peux pas vous dire juste parce que je n'ai pas été daté, comme vous allez voir quand on se connaîtra mieux, si vous trouvez que ça vaut la peine.
- Monsieur Hamil, pourquoi ne me répondez-vous pas ?
- Tu es bien jeune et quand on est très jeune, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir.
- Monsieur Hamil, est-ce qu'on peut vivre sans amour ?
* Signé Ajar, ce roman reçut le prix Goncourt en 1975. Histoire d'amour d'un petit garçon arabe pour une très vieille femme juive : Momo se débat contre les six étages que Madame Rosa ne veut plus monter et contre la vie parce que «ça ne pardonne pas» et parce qu'il n'est «pas nécessaire d'avoir des raisons pour avoir peur». Le petit garçon l'aidera à se cacher dans son «trou juif», elle n'ira pas mourir à l'hôpital et pourra ainsi bénéficier du droit sacré «des peuples à disposer d'eux-mêmes» qui n'est pas respecté par l'Ordre des médecins. Il lui tiendra compagnie jusqu'à ce qu'elle meure et même au-delà de la mort.

Blas de Santillane, mon père, après avoir longtemps porté les armes pour le service de la monarchie espagnole, se retira dans la ville où il avait pris naissance. Il y épousa une petite bourgeoise qui n'était plus de sa première jeunesse, et je vins au monde dix mois après leur mariage. Ils allèrent ensuite demeurer à Oviédo, où ma mère se mit femme de chambre, et mon père écuyer. Comme ils n'avaient pour tout bien que leurs gages, j'aurais couru risque d'être assez mal élevé, si je n'eusse pas eu dans la ville un oncle chanoine. Il se nommait Gil Perez. Il était frère aîné de ma mère et mon parrain. Représentez-vous un petit homme haut de trois pieds et demi, extraordinairement gros, avec une tête enfoncée entre les deux épaules : voilà mon oncle. Au reste, c'était un ecclésiastique qui ne songeait qu'à bien vivre, c'est-à-dire qu'à faire bonne chère ; et sa prébende, qui n'était pas mauvaise, lui en fournissait les moyens.
Il me prit chez lui dès mon enfance, et se chargea de mon éducation. Je lui parus si éveillé, qu'il résolut de cultiver mon esprit. Il m'acheta un alphabet, et entreprit de m'apprendre lui-même à lire ; ce qui ne lui fut pas moins utile qu'à moi ; car, en me faisant connaître mes lettres, il se remit à la lecture, qu'il avait toujours fort négligée, et, à force de s'y appliquer, il parvint à lire couramment son bréviaire, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il aurait encore bien voulu m'enseigner la langue latine, c'eût été autant d'argent épargné pour lui; mais hélas! le pauvre Gil Perez ! il n'en avait de sa vie su les premiers principes: c'était peut-être( car je n'avance pas cela comme un fait certain) le chanoine du chapitre le plus ignorant. Aussi j'ai ouïe dire qu'il n'avait pas obtenue son bénéfice par son érudition ; il le devait uniquement à la reconnaissance de quelques bonnes religieuses dont il avait été le discret commissionnaire, et qui avaient eu le crédit de lui faire l'ordre de prêtrise sans examens.
* Inspiré des romans picaresques espagnols, le récit de L’Histoire de Gil Blas de Santillane est conduit par le personnage lui-même, devenu vieux. Fils de petites gens, Gil Blas a cependant pu bénéficier d’une certaine instruction. Il se heurte à nombre d'obstacles et ses mésaventures donnent l'occasion à l'auteur de faire la satire de la société et des hommes. Gil Blas est à l'image du "picaro" (le gueux espagnol qui est au coeur du roman picaresque), il est un héros itinérant (sur une route d'Espagne), voire un antihéros, car il n'a rien de la grandeur héroïque des illustres chevaliers du Moyen Age par exemple ou des aristocrates mis en scène par Mme de La Fayette (auteur classique du 17ème siècle) dans La Princesse de Clèves.

RESUME (Babelio) :
"Le premier roman d'un célèbre écrivain qui cache à peine une autobiographie à la fois tendre et violente. L'histoire est celle d'un petit provincial pauvre et fragile dont on va suivre le parcours semé d'embûches, d'une enfance difficile à une maturité douloureuse. Cette sorte d'Education sentimentale avant l'heure s'adresse tout particulièrement aux adolescents à l'âme romantique et joue sur une identification très forte du lecteur à ce Petit Chose souvent si démuni devant la terrible école de la vie. Le style, de facture classique, fait de cette œuvre un des romans les plus représentatifs de la littérature du 19e siècle et a valu à son auteur le surnom de "Dickens français".
Isabel Soubelet
JE suis né le 13 mai 18…, dans une ville du Languedoc où l’on trouve, comme dans toutes les villes du Midi, beaucoup de soleil, pas mal de poussière, un couvent de carmélites et deux ou trois monuments romains.
Mon père, M. Eyssette, qui faisait à cette époque le commerce des foulards, avait, aux portes de la ville, une grande fabrique dans un pan de laquelle il s’était taillé une habitation commode, tout ombragée de platanes, et séparée des ateliers par un vaste jardin.
C’est là que je suis venu au monde et que j’ai passé les premières, les seules bonnes années de ma vie.
Aussi ma mémoire reconnaissante a-t-elle gardé du jardin, de la fabrique et des platanes un impérissable souvenir, et lorsque à la ruine de mes parents il m’a fallu me séparer de ces choses, je les ai positivement regrettées comme des êtres.
Je dois dire, pour commencer, que ma naissance ne porta pas bonheur à la maison Eyssette. La vieille Annou, notre cuisinière, m’a souvent conté depuis comme quoi mon père, en voyage à ce moment, reçut en même temps la nouvelle de mon apparition dans le monde et celle de la disparition d’un de ses clients de Marseille, qui lui emportait plus de quarante mille francs ; si bien que M. Eyssette, heureux et désolé du même coup, se demandait, comme l’autre, s’il devait pleurer pour la disparition du client de Marseille, ou rire pour l’heureuse arrivée du Petit Daniel… Il fallait pleurer, mon bon monsieur Eyssette, il fallait pleurer doublement.
C’est une vérité, je fus la mauvaise étoile de mes parents. Du jour de ma naissance, d’incroyables malheurs les assaillirent par vingt endroits.
D’abord nous eûmes donc le client de Marseille, puis deux fois le feu dans la même année, puis la grève des ourdisseuses, puis notre brouille avec l’oncle Baptiste ?, puis un procès très coûteux avec nos marchands de couleurs, puis, enfin, la révolution de 18…, qui nous donna le coup de grâce.
À partir de ce moment, la fabrique ne battit plus que d’une aile ; petit à petit, les ateliers se vidèrent : chaque semaine un métier à bas, chaque mois une table d’impression de moins. C’était pitié de voir la vie s’en aller de notre maison comme d’un corps malade, lentement, tous les jours un peu. Une fois, on n’entra plus dans les salles du second. Une autre fois, la cour du fond fut condamnée. Cela dura ainsi pendant deux ans ; pendant deux ans, la fabrique agonisa. Enfin, un jour, les ouvriers ne vinrent plus, la cloche des ateliers ne sonna pas, le puits à roue cessa de grincer, l’eau des grands bassins, dans lesquels on lavait les tissus, demeura immobile, et bientôt, dans toute la fabrique, il ne resta plus que M. et Mme Eyssette, la vieille Annou, mon frère Jacques et moi ; puis, là-bas, dans le fond, pour garder les ateliers, le concierge Colombe et son fils le petit Rouget.
C’était fini, nous étions ruinés.
J’avais alors six ou sept ans. Comme j’étais très frêle et maladif, mes parents n’avaient pas voulu m’envoyer à l’école. Ma mère m’avait seulement appris à lire et à écrire, plus quelques mots d’espagnol et deux ou trois airs de guitare, à l’aide desquels on m’avait fait, dans la famille, une réputation de petit prodige.
Grâce à ce système d’éducation, je ne bougeais jamais de chez nous, et je pus assister dans tous ses détails à l’agonie de la maison Eyssette. Ce spectacle me laissa froid, je l’avoue ; même je trouvai à notre ruine ce côté très agréable que je pouvais gambader à ma guise par toute la fabrique, ce qui, du temps des ouvriers, ne m’était permis que le dimanche. Je disais gravement au petit Rouget :
“Maintenant, la fabrique est à moi ; on me l’a donnée pour jouer.” Et le petit Rouget me croyait. Il croyait tout ce que je lui disais, cet imbécile.
À la maison, par exemple, tout le monde ne prit pas notre débâcle aussi gaiement. Tout à coup, M. Eyssette devint terrible : c’était dans l’habitude une nature enflammée, violente, exagérée, aimant les cris, la casse et les tonnerres ; au fond, un très excellent homme, ayant seulement la main leste, le verbe haut et l’impérieux besoin de donner le tremblement à tout ce qui l’entourait. La mauvaise fortune, au lieu de l’abattre, l’exaspéra. Du soir au matin, ce fut une colère formidable qui, ne sachant à qui s’en prendre, s’attaquait à tout, au soleil, au mistral, à Jacques, à la vieille Annou, à la Révolution, oh ! surtout à la Révolution !… À entendre mon père, vous auriez juré que cette révolution de 18…, qui nous avait mis à mal, était spécialement dirigée contre nous. Aussi, je vous prie de croire que les révolutionnaires n’étaient pas en odeur de sainteté dans la maison Eyssette. Dieu sait ce que nous avons dit de ces messieurs dans ce temps. là… Encore aujourd’hui, quand le vieux papa Eyssette (que Dieu me le conserve !) sent venir son accès de goutte, il s’étend péniblement sur sa chaise longue, et nous l’entendons dire :
“Oh ! ces révolutionnaires !…” À l’époque dont je vous parle, M. Eyssette n’avait pas la goutte, et la douleur de se voir ruiné en avait fait un homme terrible que personne ne pouvait approcher. Il fallut le saigner deux fois en quinze jours. Autour de lui, chacun se taisait ; on avait peur.
À table, nous demandions du pain à voix basse. On n’osait pas même pleurer devant lui. Aussi, dès qu’il avait tourné les talons, ce n’était qu’un sanglot, d’un bout de la maison à l’autre ; ma mère, la vieille Annou, mon frère Jacques et aussi mon grand frère l’abbé, lorsqu’il venait nous voir, tout le monde s’y mettait. Ma mère, cela se conçoit, pleurait de voir M. Eyssette malheureux ; l’abbé et la vieille Annou pleuraient de voir pleurer Mme Eyssette ; quant à Jacques, trop jeune encore pour comprendre nos malheurs — il avait à peine deux ans de plus que moi — il pleurait par besoin, pour le plaisir.
Un singulier enfant que mon frère Jacques ; en voilà un qui avait le don des larmes ! D’aussi loin qu’il me souvienne, je le vois les yeux rouges et la joue ruisselante. Le soir, le matin, de jour, de nuit, en classe, à la maison, en promenade, il pleurait sans cesse, il pleurait partout. Quand on lui disait :
“Qu’as-tu ?” il répondait en sanglotant : “Je n’ai rien.” Et, le plus curieux, c’est qu’il n’avait rien. Il pleurait comme on se mouche, plus souvent, voilà tout. Quelquefois M. Eyssette, exaspéré, disait à ma mère : “Cet enfant est ridicule, regardez-le… c’est un fleuve.” À quoi Mme Eyssette répondait de sa voix douce : “Que veux-tu, mon ami ? cela passera en grandissant ; à son âge, j’étais comme lui.”
En attendant, Jacques grandissait ; il grandissait beaucoup même, et cela ne lui passait pas. Tout au contraire, la singulière aptitude qu’avait cet étrange garçon à répandre sans raison des averses de larmes allait chaque jour en augmentant. Aussi la désolation de nos parents lui fut une grande fortune… C’est pour le coup qu’il s’en donna de sangloter à son aise, des journées entières, sans que personne vînt lui dire :
“Qu’as-tu ?” En somme, pour Jacques comme pour moi, notre ruine avait son joli côté.
Pour ma part, j’étais très heureux. On ne s’occupait plus de moi. J’en profitais pour jouer tout le jour avec Rouget parmi les ateliers déserts, où nos pas sonnaient comme dans une église, et les grandes cours abandonnées, que l’herbe envahissait déjà, Ce jeune Rouget, fils du concierge Colombe, était un gros garçon d’une douzaine d’années, fort comme un bœuf, dévoué comme un chien, bête comme une oie et remarquable surtout par une chevelure rouge, à laquelle il devait son surnom de Rouget. Seulement, je vais vous dire : Rouget, pour moi, n’était pas Rouget. Il était tout à tour mon fidèle Vendredi, une tribu de sauvages, un équipage révolté, tout ce qu’on voulait. Moi-même, en ce temps-là, je ne m’appelais pas Daniel Eyssette : j’étais cet homme singulier, vêtu de peaux de bêtes, dont on venait de me donner les aventures, master Crusoé lui-même. Douce folie ! Le soir, après souper, je relisais mon Robinson, je l’apprenais par cœur ; le jour, je le jouais, je le jouais avec rage, et tout ce qui m’entourait, je l’enrôlais dans ma comédie.
La fabrique n’était plus la fabrique ; c’était mon île déserte, oh ! bien déserte.
Les bassins jouaient le rôle d’Océan. Le jardin faisait une forêt vierge. Il y avait dans les platanes un tas de cigales qui étaient de la pièce et qui ne le savaient pas.
Rouget, lui non plus, ne se doutait guère de l’importance de son rôle. Si on lui avait demandé ce que c’était que Robinson, on l’aurait bien embarrassé ; pourtant je dois dire qu’il tenait son emploi avec la plus grande conviction, et que, pour imiter le rugissement des sauvages, il n’y en avait pas comme lui.
Où avait-il appris ? Je l’ignore… Toujours est-il que ces grands rugissements de sauvage qu’il allait chercher dans le fond de sa gorge, en agitant sa forte crinière rouge, auraient fait frémir les plus braves.
Moi-même, Robinson, j’en avais quelquefois le cœur bouleversé, et j’étais obligé de lui dire à voix basse ! “Pas si fort, Rouget, tu me fais peur.” Malheureusement, si Rouget, imitait le cri des sauvages très bien, il savait encore mieux dire les gros mots d’enfants de la rue et jurer le nom de Notre-Seigneur. Tout en jouant, j’appris à faire comme lui, et un jour, en pleine table, un formidable juron m’échappa je ne sais comment, Consternation générale ! “Qui t’a appris cela ? Où l’as-tu entendu ?” Ce fut un événement. M. Eyssette parla tout de suite de me mettre dans une maison de correction ; mon grand frère l’abbé dit qu’avant toute chose on devait m’envoyer à confesse, puisque j’avais l’âge de raison. On me mena à confesse. Grande affaire !
Il fallait ramasser dans tous les coins de ma conscience un tas de vieux péchés qui traînaient là depuis sept ans. Je ne dormis pas de deux nuits ; c’est qu’il y en avait toute une panerée de ces diables de péchés ; j’avais mis les plus petits dessus, mais c’est égal, les autres se voyaient, et lorsque, agenouillé dans la petite armoire de chêne, il fallut montrer tout cela au curé des Récollets , je crus que je mourrais de peur et de confusion…
Ce fut fini. Je ne voulus plus jouer avec Rouget ; je savais maintenant, c’est saint Paul qui l’a dit et le curé des Récollets me le répéta, que le démon rôde éternellement autour de nous comme un lion, quaerens quem devoret ? Oh ! ce quaerens quem devoret, quelle impression il me fit ! Je savais aussi que cet intrigant de Lucifer prend tous les visages qu’il veut pour vous tenter ; et vous ne m’auriez pas ôté de l’idée qu’il s’était caché dans la peau de Rouget pour m’apprendre à jurer le nom de Dieu. Aussi, mon premier soin, en rentrant à la fabrique, fut d’avertir Vendredi qu’il eût à rester chez lui dorénavant. Infortuné Vendredi ! Cet ukase lui creva, le cœur, mais il s’y conforma sans une plainte. Quelquefois je l’apercevais debout, sur la porte de la loge, du côté des ateliers ; il se tenait là tristement ; et lorsqu’il voyait que je le regardais, le malheureux poussait pour m’attendrir les plus effroyables rugissements, en agitant sa crinière flamboyante ; mais plus il rugissait, plus je me tenais loin. Je trouvais qu’il ressemblait au fameux lion quaerens. Je lui criais : “Va-t’en ! tu me fais horreur.” Rouget s’obstina à rugir ainsi pendant quelques jours ; puis, un matin, son père, fatigué de ses rugissements à domicile, l’envoya rugir en apprentissage, et je ne le revis plus.
Mon enthousiasme pour Robinson n’en fut pas un instant refroidi. Tout juste vers ce temps-là, l’oncle Baptiste se dégoûta subitement de son perroquet et me le donna. Ce perroquet remplaça Vendredi. Je l’installai dans une belle cage au fond de ma résidence d’hiver ; et me voilà, plus Crusoé que jamais, passant mes journées en tête-à-tête avec cet intéressant volatile et cherchant à lui faire dire : “Robinson, mon pauvre Robinson !” Comprenez-vous cela ?
Ce perroquet, que l’oncle Baptiste m’avait donné pour se débarrasser de son éternel bavardage, s’obstina à ne pas parler dès qu’il fut à moi… Pas plus “mon pauvre Robinson” qu’autre chose ; jamais je n’en pus rien tirer. Malgré cela, je l’aimais beaucoup et j’en avais le plus grand soin.
Nous vivions ainsi, mon perroquet et moi, dans la plus austère solitude, lorsqu’un matin il m’arriva une chose vraiment extraordinaire. Ce jour-là, j’avais quitté ma cabane de bonne heure et je faisais, armé jusqu’aux dents, un voyage d’exploration à travers mon île… Tout à coup, je vis venir de mon côté un groupe de trois ou quatre personnes, qui parlaient à voix très haute et gesticulaient vivement. Juste Dieu ! des hommes dans mon île ! Je n’eus que le temps de me jeter derrière un bouquet de lauriers roses, et à plat ventre, s’il vous plaît… Les hommes passèrent près de moi sans me voir… Je crus distinguer la voix du concierge Colombe, ce qui me rassura un peu ; mais, c’est égal, dès qu’ils furent loin je sortis de ma cachette et je les suivis à distance pour voir ce que tout cela deviendrait…
Ces étrangers restèrent longtemps dans mon île.
Ils la visitèrent d’un bout à l’autre dans tous ses détails. Je les vis entrer dans mes grottes et sonder avec leurs cannes la profondeur de mes océans. De temps en temps ils s’arrêtaient et remuaient la tête.
Toute ma crainte était qu’ils ne vinssent à découvrir mes résidences… Que serais-je devenu, grand Dieu !
Heureusement, il n’en fut rien, et au bout d’une demi-heure, les hommes se retirèrent sans se douter seulement que l’île était habitée. Dès qu’ils furent partis, je courus m’enfermer dans une de mes cabanes, et passai là le reste du jour à me demander quels étaient ces hommes et ce qu’ils étaient venus faire.
J’allais le savoir bientôt.
Le soir, à souper, M. Eyssette nous annonça solennellement que la fabrique était vendue, et que, dans un mois, nous partirions tous pour Lyon, où nous allions demeurer désormais.
Ce fut un coup terrible. Il me sembla que le ciel croulait. La fabrique vendue !… Eh bien, et mon île, mes grottes, mes cabanes ? Hélas ! l’île, les grottes, les cabanes, M. Eyssette avait tout vendu ; il fallait tout quitter. Dieu, que je pleurais !…
Pendant un mois, tandis qu’à la maison on emballait les glaces, la vaisselle, je me promenais triste et seul dans ma chère fabrique, Je n’avais plus le cœur à jouer, vous pensez… oh ! non… J’allais m’asseoir dans tous les coins, et regardant les objets autour de moi, je leur parlais comme à des personnes ; je disais aux platanes : “Adieu, mes chers amis !” et aux bassins : “C’est fini, nous ne nous verrons plus !” Il y avait dans le fond du jardin un grand grenadier dont les belles fleurs rouges s’épanouissaient au soleil. Je lui dis en sanglotant : “Donne-moi une de tes fleurs.” Il me la donna. Je la mis dans ma poitrine, en souvenir de lui. J’étais très malheureux.
Pourtant, au milieu de cette grande douleur, deux choses me faisaient sourire : d’abord la pensée de monter sur un navire, puis la permission qu’on’m’avait donnée d’emporter mon perroquet avec moi.
Je me disais que Robinson avait quitté son île dans des conditions à peu près semblables, et cela me donnait du courage.
Enfin, le jour du départ arriva. M. Eyssette était déjà à Lyon depuis une semaine. Il avait pris les devant avec les gros meubles. Je partis donc en compagnie de Jacques, de ma mère et de la vieille Annou. Mon grand frère l’abbé ne partait pas, mais il nous accompagna jusqu’à la diligence de Beaucaire ?, et aussi le concierge Colombe nous accompagna. C’est lui qui marchait devant en poussant une énorme brouette chargée de malles. Derrière venait mon frère l’abbé, donnant le bras à Mme Eyssette.
Mon pauvre abbé, que je ne devais plus revoir !
La vieille Annou marchait ensuite, flanquée d’un énorme parapluie bleu et de Jacques, qui était bien content d’aller à Lyon, mais qui sanglotait tout de même… Enfin, à la queue de la colonne venait Daniel Eyssette, portant gravement la cage du perroquet et se retournant à chaque pas du côté de sa chère fabrique.
À mesure que la caravane s’éloignait, l’arbre aux grenades se haussait tant qu’il pouvait par-dessus les murs du jardin pour la voir encore une fois… Les platanes agitaient leurs branches en signe d’adieu…
Daniel Eyssette, très ému, leur envoyait des baisers à tous, furtivement et du bout des doigts.
Je quittai mon île le 30 septembre 18…
- Pourquoi me soutenir que tu sais ta leçon ? Tu vois bien que tu ne la sais !...Tu l'as apprise par coeur ? vraiment ?
Une gifle claqua.
- Monte dans ta chambre. Que je ne te voie plus jusqu'au dîner.
L'enfant porta sa main à sa joue, comme s'il avait eu la mâchoire brisée :"oh! là! là! vous m'avez fait mal ! (il marquait un point, il prenait son avantage.) Je le dirai à Mamie..."
Paule saisit avec rage le bras fluet de son fils et lui administra une seconde gifle.
- A mamie ? et celle-là ? Est-ce à papa que tu vas aller t'en plaindre ? Eh bien, qu'est-ce que tu attends ? allons, va !
Elle le poussa dans le couloir, ferma la porte, la rouvrit pour jeter à Guillaume son livre et ses cahier. Il s'accroupit et les ramassa, toujours pleurant. Puis d'un seul coup, le silence : à peine un reniflement dans l'ombre. Il détalait enfin ! Elle écoutait le bruit décroissant de sa course. Bien sûr, ce n'était pas dans la chambre de son père qu'il irait chercher un refuge. Et puisque à ce moment même, sa grand mère, sa "Mamie", tentait pour lui une démarche auprès de l'instituteur, il irait se faire plaindre à la cuisine par Fraülein. Déjà il devait"lécher une casserole" sous le regard attendri de l'Autrichienne. "Je le vois d'ici..." Ce que Paule voyait, quand elle pensait à son fils, c'étaient des genoux cagneux, des cuisses étiques, des chaussettes rabattues sur les souliers. A ce petit être sorti d'elle, la mère ne tenait aucun compte de ses larges yeux couleur mûres, mais en revanche elle haïssait cette bouche toujours ouverte d'enfant qui respire mal, cette lèvre inférieure un peu pendante, beaucoup moins que ne l'était celle de son père, mais il suffisait à Paule qu'elle lui rappelât une bouche détestée. La rage en elle refluait : la rage, ou simplement peut être l'exaspération ? mais il n'est pas si aisé de discerner l'exaspération de la haine. Elle revint dans la chambre, s'arrêta un instant devant la glace de l'armoire. Cette blouse de laine verdâtre, elle la reprenait chaque automne, l'encolure était trop large. Ces taches avaient reparu malgré le nettoyage. La jupe marron, mouchetée de boue, était légèrement relevée par-devant comme si Paule eût été enceinte. Dieu savait pourtant !

Sale, bête et paresseux. Guillou, surnommé " le Sagouin " par sa mère, est un enfant timide et réservé. Dernier héritier d'une famille trop vite passée de noblesse à misère, il ne trouve de repos que dans la lecture – rare, hélas – des romans d'aventures. Alors que tous le considère comme perdu, la rencontre d'un jeune professeur change la donne. Le Sagouin serait-il finalement bon à quelque chose ?
François Mauriac a mis le meilleur de son art dans cette cruelle peinture d'une famille d'aristocrates décadents.
(cf. présentation FNAC)
— Je parie, dit madame Lepic, qu’Honorine a encore oublié de fermer les poules.
C’est vrai. On peut s’en assurer par la fenêtre. Là-bas, tout au fond de la grande cour, le petit toit aux poules découpe, dans la nuit, le carré noir de sa porte ouverte.
— Félix, si tu allais les fermer ? dit madame Lepic à l’aîné de ses trois enfants.
— Je ne suis pas ici pour m’occuper des poules, dit Félix, garçon pâle, indolent et poltron.
— Et toi, Ernestine ?
— Oh ! moi, maman, j’aurais trop peur !
Grand frère Félix et sœur Ernestine lèvent à peine la tête pour répondre. Ils lisent, très intéressés, les coudes sur la table, presque front contre front.
— Dieu, que je suis bête ! dit madame Lepic. Je n’y pensais plus. Poil de Carotte, va fermer les poules !
Elle donne ce petit nom d’amour à son dernier né, parce qu’il a les cheveux roux et la peau tachée. Poil de Carotte, qui joue à rien sous la table, se dresse et dit avec timidité :
— Mais, maman, j’ai peur aussi, moi.
— Comment ? répond madame Lepic, un grand gars comme toi ! c’est pour rire. Dépêchez-vous, s’il te plaît !
— On le connaît ; il est hardi comme un bouc, dit sa sœur Ernestine.
— Il ne craint rien ni personne, dit Félix, son grand frère.
Ces compliments enorgueillissent Poil de Carotte, et, honteux d’en être indigne, il lutte déjà contre sa couardise. Pour l’encourager définitivement, sa mère lui promet une gifle.
— Au moins, éclairez-moi, dit-il.
Madame Lepic hausse les épaules, Félix sourit avec mépris. Seule pitoyable, Ernestine prend une bougie et accompagne petit frère jusqu’au bout du corridor.
— Je t’attendrai là, dit-elle.
Mais elle s’enfuit tout de suite, terrifiée, parce qu’un fort coup de vent fait vaciller la lumière et l’éteint.
Poil de Carotte, les fesses collées, les talons plantés, se met à trembler dans les ténèbres. Elles sont si épaisses qu’il se croit aveugle. Parfois une rafale l’enveloppe, comme un drap glacé, pour l’emporter. Des renards, des loups même, ne lui soufflent-ils pas dans ses doigts, sur sa joue ? Le mieux est de se précipiter, au juger, vers les poules, la tête en avant, afin de trouer l’ombre. Tâtonnant, il saisit le crochet de la porte. Au bruit de ses pas, les poules effarées s’agitent en gloussant sur leur perchoir. Poil de Carotte leur crie :
— Taisez-vous donc, c’est moi !
ferme la porte et se sauve, les jambes, les bras comme ailés. Quand il rentre, haletant, fier de lui, dans la chaleur et la lumière, il lui semble qu’il échange des loques pesantes de boue et de pluie contre un vêtement neuf et léger. Il sourit, se tient droit, dans son orgueil, attend les félicitations, et maintenant hors de danger, cherche sur le visage de ses parents la trace des inquiétudes qu’ils ont eues.
Mais grand frère Félix et sœur Ernestine continuent tranquillement leur lecture, et madame Lepic lui dit, de sa voix naturelle :
— Poil de Carotte, tu iras les fermer tous les soirs.
Illustrations de François DUPRAT et Texte de Hugues BARTHES ã JE BOUQUINE, Bayard Jeunesse, 2006

Poil de Carotte est un petit garçon mal aimé. Souffre-douleur de sa mère, il est aussi raillé par ses frères, délaissé par son père… Face à l’injustice, l’enfant ne possède que la ruse, le mensonge et l’humour. Des armes qu’il manie à merveille ! Dans ces saynètes drôles, touchantes et parfois terribles, inspirées de sa propre enfance, Jules Renard déploie l’ironie et l’humanité qui rendent son style unique.
Dois-je être le héros de ma propre histoire, ou ce rang y sera-t-il occupé par un autre que moi ? c’est ce qu’on verra dans ces pages. Pour commencer par le commencement, je naquis (on me l’a dit et je le crois) un vendredi, à minuit. On remarqua que l’horloge frappait son premier coup de marteau sur l’airain et que je poussais mon premier cri simultanément.
Considérant le jour et l’heure de ma naissance, la garde de l’accouchée et quelques sages commères du voisinage à qui j’avais inspiré le plus vif intérêt plusieurs mois avant qu’il fût possible que nous fissions connaissance, déclarèrent deux choses : — premièrement que j’étais prédestiné à être malheureux ; — secondement que j’aurais le privilège de voir des spectres et des esprits, ce qui était le partage inévitable de tous les enfants infortunés de l’un et de l’autre sexe venus au monde le vendredi depuis minuit jusqu’au matin.
Sur le premier point, je ne m’expliquerai pas ici : mon histoire montrera suffisamment si la prédiction s’est accomplie ; sur le second, je me contenterai de dire qu’à moins d’avoir vu des spectres et des esprits quand j’étais dans mon berceau, je les attends encore. Mais je ne me plains pas qu’on m’ait privé de cette part de mon héritage, et si quelqu’un, par hasard, en jouit à ma place, je la lui laisse de bien bon cœur.
Je naquis avec une coiffe sur la tête, qui fut annoncée en vente, dans les feuilles publiques, au prix peu élevé de quinze guinées [1] ; soit que les marins et les gens allant à la mer fussent à court d’argent à cette époque, soit qu’ils fussent à court de foi et préférassent une camisole en liège, il ne se présenta qu’un seul chaland pour acheter ma coiffe, et c’était un courtier de change qui offrit deux livres sterling en argent avec le surplus en vin de Xérès, ne voulant être garanti de la chance de se noyer à aucune autre condition. Par suite, ma pauvre mère en fut pour ses frais d’annonce, car elle était alors forcée de vendre elle-même son propre xérès. Dix ans après, on mit la coiffe en loterie à une demi-couronne le billet, le gagnant étant tenu de payer une demi-couronne en sus pour les frais. Cinquante billets furent placés et le tirage eut lieu. J’y assistai : je me rappelle mon embarras et ma confusion quand je vis disposer ainsi d’une partie de moi-même. Le billet gagnant avait été pris par une vieille dame qui, bien à contre-cœur, tira d’un panier la somme stipulée toute en menue monnaie, dont deux pièces rognées, ce qu’elle ne voulut nullement reconnaître, quoiqu’on perdit je ne sais combien de temps à le lui prouver arithmétiquement. C’est un fait remarquable, qu’on citera souvent, que la brave dame ne fut jamais noyée et mourut triomphalement dans son lit à l’âge de quatre-vingt-douze ans. On prétend qu’elle se vantait fièrement de n’avoir jamais été sur l’eau, excepté en passant un pont, et que lorsqu’elle prenait le thé (elle prenait volontiers le thé), elle avait pour habitude constante d’exhaler son indignation contre l’impiété des marins ou de tous autres individus assez présomptueux pour aller s’égarer en mer sous prétexte de courir le monde. Vainement lui représentait-on que quelques agréments de la vie, le thé peut-être compris, étaient dus à cette présomption qui l’indignait, elle répliquait toujours, avec un nouveau degré d’emphase et de plus en plus sûre de la force de son objection : « Non, non, n’allons pas nous égarer. »
De peur de m’égarer moi-même en ce moment, je reviens à ma naissance.
Je naquis à Blunderstone, dans le comté de Suffolk, ou « pas loin de là, » comme on dit en Écosse. J’étais un enfant posthume. Il y avait six mois que les yeux de mon père s’étaient fermés à la lumière de ce monde, lorsque les miens s’ouvrirent. J’éprouve toujours je ne sais quelle sensation étrange en pensant qu’il ne me vit jamais, une sensation plus étrange encore en revenant aux vagues réminiscences qui associent mes premières réflexions d’enfant avec la pierre blanche de sa tombe dans le cimetière. Je n’oublierai jamais la pitié indéfinissable qui me saisissait quand je me figurais mon père abandonné là, seul, dans les ténèbres de la nuit, tandis que notre petit salon, bien chaud et bien éclairé, lui fermait cruellement ses portes !
Une tante de mon père, et, par conséquent, une grand’tante à moi, était le personnage éminent de notre famille. Elle jouera un grand rôle dans mon histoire. Miss Trotwood, ou Miss Betsey, comme ma pauvre mère l’appelait lorsqu’elle parvenait à contenir assez sa terreur de ce personnage redoutable pour en parler, — ce qui était rare, — Miss Betsey avait épousé un mari plus jeune qu’elle, un fort bel homme, mais non dans le sens de l’adage qui dit qu’on est beau quand on est bon, car il était fortement soupçonné d’avoir battu Miss Betsey, et même, un jour, sur une question de subsides, d’avoir fait mine de répondre à l’opposition de sa chère moitié en la jetant par la fenêtre d’un deuxième étage. Ces preuves d’incompatibilité d’humeur avaient obligé Miss Betsey à s’en débarrasser moyennant finances, et les deux époux s’étaient séparés à l’amiable. Le mari s’en alla dans l’Inde avec son capital, et là, d’après une tradition de la famille, on l’aperçut une fois sur un éléphant en compagnie d’un babouin… Était-ce une vraie guenon ou une begum, princesse mogole, appelée aussi une babou ? Je penche pour cette dernière version. Quoi qu’il en soit, dix ans plus tard, la nouvelle de sa mort arriva en Angleterre. Comment cette nouvelle affecta-t-elle ma tante ? Personne ne le sait ; car immédiatement après la séparation, elle avait repris son nom de fille, avait acheté une maisonnette ou cottage dans un hameau sur les bords de la mer, et s’était établie là, seule avec une servante, en véritable recluse.
Mon père avait été son neveu favori, à ce que je crois ; mais elle s’était tenue pour mortellement offensée de son mariage, sous prétexte que ma mère n’était qu’une « poupée de cire. » Elle n’avait jamais vu ma mère ; mais elle savait qu’elle n’avait pas vingt ans. Mon père et Miss Betsey ne se revirent plus. Il avait le double de l’âge de ma mère en l’épousant, et, étant d’une santé faible, il mourut au bout d’une année ou, comme je l’ai dit, six mois avant que je vinsse au monde.
Tel était l’état des choses l’après-midi de ce jour du mois de mars qu’on m’excusera d’appeler le « mémorable vendredi. » Ma mère était assise près du feu, souffrante, triste, rêvant à elle-même et au pauvre petit orphelin qui allait lui naître, lorsque, levant la tête après avoir essuyé quelques larmes, elle aperçut à travers la fenêtre une femme étrangère qui venait par le jardin.
Ma mère eut un pressentiment que c’était Miss Betsey. Il y avait dans sa taille, sa démarche et toute sa personne une telle raideur, que ce ne pouvait être une autre qu’elle. Quand elle fut près de la maison, elle donna une autre preuve de son identité. Mon père avait souvent répété qu’elle se conduisait rarement comme tout le monde : au lieu de sonner, elle vint droit à la fenêtre par laquelle ma mère l’avait vue et appuya son nez contre la vitre.
Telle fut l’impression causée par cette visite, que j’ai toujours été persuadé qu’à Miss Betsey je dois d’être né un vendredi.

L'Adolescent est l'avant-dernier roman de l'écrivain russe Fiodor Dostoïevski. Il fut d'abord publié dans la revue Les Annales de la Patrie de janvier à décembre 1875, puis en trois volumes en 1876.
Le roman raconte quelques semaines de la vie d'Arkadi Makarovitch Dolgorouki, jeune homme solitaire, fils illégitime d'un aristocrate et d'une domestique, qui entretient des relations difficiles avec ses proches et qui préfère se plonger dans des réflexions chaotiques pour mieux exposer son « idée ».
"N'y tenant plus, je commence à écrire cette histoire de mes premiers pas dans la carrière de la vie. Et pourtant j'aurais pu m'en passer. Il est une chose certaine : c'est que jamais plus je n'écrirai mon autobiographie, dussé-je vivre cent ans."
Fédor DOSTOIEVSKI, L'adolescent (1875)
Je suis un lycéen qui a fini ses études, mais, aujourd’hui, j’ai déjà vingt ans passés. Mon nom est Dolgorouki, et, juridiquement, mon père est Makar Ivanov Dolgorouki, ancien domestique des seigneurs Versilov. Sous cet angle-là, je suis légitime, même si, au plus haut point, je suis un fils illégitime et si mon origine ne peut pas faire l’objet du moindre doute. L’affaire s’est passée ainsi : voici vingt-deux ans, le propriétaire terrien Versilov (mon père, c’est lui), âgé de vingt-cinq ans, a fait une visite dans son domaine de la province de Toula. […] Il est curieux que cet homme qui m’a tellement frappé depuis la petite enfance, qui a eu une influence si capitale sur tout le caractère de mon âme, et qui, même, peut-être, a pour longtemps encore contaminé de sa personne tout mon avenir, que cet homme, donc, et aujourd’hui encore, reste toujours pour moi, pour une quantité de choses énorme, une énigme totale. Mais, au fond – ça, plus tard. On ne peut pas raconter comme ça. Cet homme-là, déjà sans ça, il remplira tout mon cahier.
A ce moment-là, il venait juste de devenir veuf, c’est-à-dire la vingt-cinquième année de sa vie. Il avait été marié à une personne du grand monde, mais pas si riche que ça, une Fanariotova, et avait eu d’elle un fils et une fille. […]
Il était arrivé au village à l’époque « Dieu sait pourquoi », du moins, c’est ainsi qu’il me l’a dit plus tard. Ses jeunes enfants n’étaient pas avec lui, comme d’habitude, mais chez des parents ; c’est toujours ainsi qu’il s’est comporté toute sa vie avec ses enfants, légitimes et illégitimes. Des domestiques, dans ce domaine, il y en avait une quantité ; et, parmi eux, le jardinier Makar Ivanov Dolgorouki. Je place ça ici, pour m’en défaire une fois pour toutes : rarement quelqu’un a pu pester autant que moi contre son nom de famille, et, ce, tout au long de ma vie. C’est un fait bête, bien sûr, mais c’est un fait. Parce que chaque fois que j’entrais, par exemple, à l’école, ou que je rencontrais des gens, auxquels, vu mon âge, je devais obéir, bref, le moindre petit instituteur, surveillant, inspecteur, le moindre pope – tous, n’importe - , qui demandait mon nom de famille et entendait que j’étais un Dolgorouki, trouvait, je ne sais pas pourquoi, absolument indispensable d’ajouter :
- Prince Dolgorouki ?
Et, chaque fois, moi, j’étais obligé d’expliquer à tous ces oisifs :
- Non, Dolgorouki tout court.
Tome 1, traduit par A. MARKOWICZ. Actes Sud, 1998.
NOTES (édition Folio Classique) :
« Je » : tout le récit est présenté comme écrit par l’Adolescent, à titre non pas de journal, mais de souvenirs. Dostoïevski ne s’est décidé à cette forme qu’après avoir longtemps hésité. Le 12 août 1874, il note : « Importante solution du problème : écrire en son nom propre. Commencer par le mot : Je. La confession d’un grand pécheur… »
Les Dolgorouki étaient une famille princière bien connue : Georges Dolgorouki avait fondé au 12ème siècle la principauté de Souzdal.
On apprendra ensuite que Versilov avait commencé à entretenir une liaison avec la mère du narrateur six mois seulement après son mariage avec Makar Dolgorouki. Versilov rachètera sa maîtresse à Makar Ivanov, l’emmenant avec lui ou la laissant aux bons soins de sa tante. Quant au fils né un an après le début de leur relation, il sera placé chez des étrangers. Jusqu’à sa vingtième année, il ne verra que rarement sa mère.
Le 15 septembre 1840, vers six heures du matin, la Ville-de-Montereau, près de partir, fumait à gros tourbillons devant le quai Saint-Bernard.
Des gens arrivaient hors d’haleine ; des barriques, des câbles, des corbeilles de linge gênaient la circulation ; les matelots ne répondaient à personne ; on se heurtait ; les colis montaient entre les deux tambours, et le tapage s’absorbait dans le bruissement de la vapeur, qui, s’échappant par des plaques de tôle, enveloppait tout d’une nuée blanchâtre, tandis que la cloche, à l’avant, tintait sans discontinuer.
Enfin le navire partit ; et les deux berges, peuplées de magasins, de chantiers et d’usines, filèrent comme deux larges rubans que l’on déroule.
Un jeune homme de dix-huit ans, à longs cheveux et qui tenait un album sous son bras, restait auprès du gouvernail, immobile. À travers le brouillard, il contemplait des clochers, des édifices dont il ne savait pas les noms ; puis il embrassa, dans un dernier coup d’œil, l’île Saint-Louis, la Cité, Notre-Dame ; et bientôt, Paris disparaissant, il poussa un grand soupir.
M. Frédéric Moreau, nouvellement reçu bachelier, s’en retournait à Nogent-sur-Seine, où il devait languir pendant deux mois, avant d’aller faire son droit. Sa mère, avec la somme indispensable, l’avait envoyé au Havre voir un oncle, dont elle espérait, pour lui, l’héritage ; il en était revenu la veille seulement ; et il se dédommageait de ne pouvoir séjourner dans la capitale, en regagnant sa province par la route la plus longue.
Le tumulte s’apaisait ; tous avaient pris leur place ; quelques-uns, debout, se chauffaient autour de la machine, et la cheminée crachait avec un râle lent et rythmique son panache de fumée noire ; des gouttelettes de rosée coulaient sur les cuivres ; le pont tremblait sous une petite vibration intérieure, et les deux roues, tournant rapidement, battaient l’eau.
La rivière était bordée par des grèves de sable. On rencontrait des trains de bois qui se mettaient à onduler sous le remous des vagues, ou bien, dans un bateau sans voiles, un homme assis pêchait ; puis les brumes errantes se fondirent, le soleil parut, la colline qui suivait à droite le cours de la Seine peu à peu s’abaissa, et il en surgit une autre, plus proche, sur la rive opposée.
Des arbres la couronnaient parmi des maisons basses couvertes de toits à l’italienne. Elles avaient des jardins en pente que divisaient des murs neufs, des grilles de fer, des gazons, des serres chaudes, et des vases de géraniums, espacés régulièrement sur des terrasses où l’on pouvait s’accouder. Plus d’un, en apercevant ces coquettes résidences, si tranquilles, enviait d’en être le propriétaire, pour vivre là jusqu’à la fin de ses jours, avec un bon billard, une chaloupe, une femme ou quelque autre rêve. Le plaisir tout nouveau d’une excursion maritime facilitait les épanchements. Déjà les farceurs commençaient leurs plaisanteries. Beaucoup chantaient. On était gai. Il se versait des petits verres.
Frédéric pensait à la chambre qu’il occuperait là-bas, au plan d’un drame, à des sujets de tableaux, à des passions futures. Il trouvait que le bonheur mérité par l’excellence de son âme tardait à venir. Il se déclama des vers mélancoliques ; il marchait sur le pont à pas rapides ; il s’avança jusqu’au bout, du côté de la cloche ; — et, dans un cercle de passagers et de matelots, il vit un monsieur qui contait des galanteries à une paysanne, tout en lui maniant la croix d’or qu’elle portait sur la poitrine. C’était un gaillard d’une quarantaine d’années, à cheveux crépus. Sa taille robuste emplissait une jaquette de velours noir, deux émeraudes brillaient à sa chemise de batiste, et son large pantalon blanc tombait sur d’étranges bottes rouges, en cuir de Russie, rehaussées de dessins bleus.
La présence de Frédéric ne le dérangea pas. Il se tourna vers lui plusieurs fois, en l’interpellant par des clins d’œil ; ensuite il offrit des cigares à tous ceux qui l’entouraient. Mais, ennuyé de cette compagnie, sans doute, il alla se mettre plus loin ; Frédéric le suivit.
La conversation roula d’abord sur les différentes espèces de tabacs, puis, tout naturellement, sur les femmes. Le monsieur en bottes rouges donna des conseils au jeune homme ; il exposait des théories, narrait des anecdotes, se citait lui-même en exemple, débitant tout cela d’un ton paterne, avec une ingénuité de corruption divertissante.
Il était républicain : il avait voyagé, il connaissait l’intérieur des théâtres, des restaurants, des journaux, et tous les artistes célèbres, qu’il appelait familièrement par leurs prénoms ; Frédéric lui confia bientôt ses projets ; il les encouragea.
Mais il s’interrompit pour observer le tuyau de la cheminée, puis il marmotta vite un long calcul, afin de savoir « combien chaque coup de piston, à tant de fois par minute, devait, etc. » — Et, la somme trouvée, il admira beaucoup le paysage. Il se disait heureux d’être échappé aux affaires.
Le monde est perçu à travers trois points de vue différents et alternés :
a) Point de vue externe (focalisation externe) : depuis le début du texte jusqu'à : "sans discontinuer".
b) Point de vue interne (focalisation interne), à travers le regard d'un passagers immobile, Frédéric Moreau lui-même : depuis "Enfin le navire partit" jusqu'à "deux larges rubans que l'on déroule".
c) Point de vue externe : "Un jeune homme de dix-huit ans, à longs cheveux et qui tenait un album sous son bras, restait auprès du gouvernail, immobile."
d) Point de vue interne : depuis "A travers le brouillard, il contemplait des clochers" jusqu'à "il poussa un grand soupir", qui nous fait partager le regard du personnage, mais aussi les émotions qu'il ressent.
e) Dans le dernier paragraphe, le narrateur adopte un point de vue omniscient : il sait tout du personnage : son passé : "nouvellement reçu bachelier", "sa mère l'avait envoyé au Havre", il en était revenu la veille seulement" ; le présent : "il se dédommageait de ne pouvoir séjourner dans la capitale, en regagnant sa province par la route la plus longue, son avenir : "il s'en retournait à Nogent-Sur-Seine où il devait languir pendant deux mois, avant d'aller faire son droit."
La variation des temps verbaux : imparfait ("s'en retournait", "espérait", se dédommageait") futur dans le passé (où il devait languir"), plus-que parfait (sa mère l'avait envoyé, il en était revenu") suggère la coexistence et le "télescopage" du passé, du présent et du futur dans la conscience humaine où l'Etre et le Temps ne font qu'un.
Le narrateur commence par évoquer les préparatifs de départ et le départ proprement dit. Le personnage apparaît "in medias res" et se détache sur le fond du monde environnant. Ce n'est donc pas lui qui a le rôle principal, mais le monde qui lui préexiste et qui lui survivra. Le portrait de Frédéric Moreau est une satire discrète de la pose romantique : les cheveux longs, le carnet de croquis sous le bras, l'immobilité, la proximité du gouvernail, le regard perdu dans les horizons lointains... La présentation tardive du personnage et son aspect légèrement satirique suggère l'insignifiance relative des individus par rapport à la société dans son ensemble et par rapport au monde en général.
La description est analogue à un mouvement de caméra : elle commence par un plan moyen sur l'agitation du quai, puis par un plan large sur le paysage, puis par un gros plan sur le personnage, pour finir par un plan large sur le paysage vu par le personnage.
"Un jeune homme de dix-huit ans, à longs cheveux et qui tenait un album sous le bras, restait auprès du gouvernail, immobile." : la construction en hyperbate et l'adjectif qualificatif "immobile" en position d'épithète détachée en fin de phrase, contraste avec l'agitation et le mouvement qui président au départ du bateau : "les deux berges filèrent comme deux larges rubans que l'on déroule."
Le narrateur insiste sur le caractère contemplatif du personnage : "A travers le brouillard, il contemplait des clochers, des édifices dont il ne savait pas les noms. Le brouillard apparaît dans l'œuvre de Flaubert, notamment dans Madame Bovary, dans les moments d'illusion romantique : les choses sont d'autant plus désirables qu'elles sont éloignées et floues.
Le narrateur suggère ses sentiments : la tristesse et la déception de ne pouvoir rester à Paris : "puis il embrassa, dans un dernier coup d'œil, l'île Saint-Louis, la Cité, Notre-Dame ; et bientôt, Paris disparaissant (le participe présent exprime à la fois une action et une relation de cause à effet), il poussa un grand soupir."
Le paysage se donne à Frédéric Moreau dans une dimension érotique : les deux berges filèrent comme deux larges rubans que l'on déroule.", "puis il embrassa dans un dernier regard..." qui préfigure, dans la rêverie, la rencontre amoureuse. La contemplation d’un paysage mouvant personnifié est donc la première étape de "l'éducation sentimentale".
Le point de vue omniscient permet à Flaubert de donner en quelques lignes un grand nombre d'informations sur le passé, le présent et l'avenir du personnage : il vient de sortir du lycée et d'obtenir le baccalauréat, il s'en retourne chez sa mère : "Sa mère, avec la somme indispensable, l'avait envoyé au Havre voir un oncle, dont elle espérait, pour lui, l'héritage."
Le personnage est en décalage par rapport au mouvement qui caractérise le texte (mouvement des êtres et des choses) : il est immobile, il tient son carnet de croquis sous le bras, mais ne s'en sert pas, il se contente de regarder le paysage, il ressent de la tristesse car, comme son histoire le montre, il n'a pas eu jusqu'à présent l'occasion de mener sa vie à sa guise : il est sous la dépendance financière et matérielle de sa mère, il s'est rendu au Havre auprès d'un oncle à héritage comme elle le lui avait demandé, il emprunte le chemin des écoliers - conduite magique typique de l'enfance - pour rentrer chez lui : "Il se dédommageait de ne pouvoir séjourner dans la capitale, en regagnant sa province par la route la plus longue."
Ces caractéristiques de départ : la jeunesse, la tendance à contempler les choses plutôt qu'à agir sur elles, le côté "artiste", la "naïveté" du personnage, contribuent à faire de Frédéric Moreau le héros type du roman d'apprentissage. Mais ce regard discrètement ironique d'autodérision, n'est pas dénué d'affection envers un double qui ressemble à l'auteur comme un frère, lorsqu'il avait son âge.
L’incipit inscrit les thèmes essentiels de l’œuvre :
- Observer l'énonciation et le mode de narration :
a) Qui raconte et prend en charge le récit ? S'agit-il d'un personnage de l'histoire (narrateur intra-diégétique) ? d'un témoin ? d'un narrateur extérieur (narrateur extra-diégétique) ?
b) Repérer le jeu avec les pronoms personnels : s'adresse-t-on à quelqu'un en particulier ? (par exemple au lecteur ?) reste-t-on dans une narration distanciée, à la troisième personne ?
c) Observer si on a affaire à du récit, du discours, de la description... : le discours direct peut ouvrir un incipit dit "in medias res" (ex : DIB, La Grande Maison), la description est plus traditionnelle et attendue dans les romans réalistes de type balzacien (on situe dans une époque et un cadre spatial précis l'action qui tarde à venir).
- Se questionner sur la posture de l'auteur et du narrateur : a-t-on le sentiment que les deux instances se confondent ou reste-t-on dans une séparation franche qui amène un effacement complet de l'auteur ?
Ex : Lesage donne la parole à Gil Blas vieilli, qui relate ses mésaventures de jeune homme.
Ex : Vallès met en scène la parole de Jacques Vingtras, revenant également sur son passé, l'enfance, mais on a l'impression d'entrer dans un monologue intérieur où il ressasse ses souvenirs : "Ai-je été nourri par ma mère ?" est une ouverture percutante qui est lourde de sous-entendus. On imagine que le rapport à la mère aura un poids important dans le roman autobiographique.
Examiner les indices d'énonciation qui nous signalent une part de subjectivité, un parti pris en faveur de son personnage ou au contraire de la moquerie, voire du cynisme.
Ex : M. Dib, dans Le Métier à tisser, émaille son récit de passages flirtant avec le discours indirect libre, il donne à entendre un discours polyphonique qui superposerait plusieurs voix (celles de la mère, des soeurs, d'Omar, mais aussi celle du narrateur ou potentiellement de la doxa), en particulier dans le moment de l'incipit où il est question des errances du jeune Omar qui provoquent beaucoup de scènes d'éclat avec la mère. Voici dans l'extrait ci-dessous des marques de subjectivité qui transparaissent dans le choix de mots familiers connotant un certain attendrissement du narrateur pour ce satané "galopin", toujours à traîner et faire perdre patience à sa mère rongée d'inquiétude.
EXTRAIT DU METIER A TISSER : "Il avait bien été question de lui chercher une autre place ; cependant une année s'était passée, et il ne fichait toujours pas une rame. S'il y eut jamais galopin qui traînât dans les rues, franc de collier, insoucieux de l'heure, du temps qu'il faisait, des réprimandes de sa mère, c'était bien lui alors !" (page 11)
- Cerner le point de vue et son évolution : il est fréquent que l'auteur varie les focalisations pour dynamiser son récit et impliquer le lecteur. Ainsi on peut noter dans le début de M. Dib (Le Métier à tisser) des passages relatés selon le point de vue objectif et distancié (externe), comme s'il s'agissait d'une caméra plantée à un endroit précis, notamment lorsque les dialogues ont lieu (au discours direct). On peut presque considérer des notations descriptives sur les gestes, les expressions du visage, les positions des personnages, comme des didascalies au théâtre. Puis on bascule au point de vue omniscient (appelé aussi focalisation zéro), parfois dans un bref passage, où le narrateur prouve qu'il en sait plus que ce qu'il ne décrit et nous fait voir, il est capable de retours en arrière ou d'anticipations, mais aussi de déceler les pensées des personnages. Du reste, il privilégie le point de vue interne pour nous introduire dans les perceptions et les émotions, les réflexions ou questionnements du protagoniste, voire ses "voix intérieures" (cf. dialogue fictif avec la mère qui dort) : on rencontre alors des verbes de sensations (lexique de la vue, de l'ouïe, etc.) qui indiquent que tout ce qui est décrit est perçu par le regard ou les oreilles d'Omar. M. Dib dévoile volontiers l'imagination ou la rêverie du garçon qui, de même qu'il erre dans les rues, laisse vagabonder sa mémoire ou ses idées, par associations. Ainsi une proposition signale l'immersion dans la conscience du personnage : "un flot d'images courait". A partir de cette expression, Dib construit plusieurs paragraphes pour traduire les visions qui traversent l'esprit de son jeune héros, au moment où il cherche le sommeil, seul dans une nuit d'orage, allongé auprès de sa mère endormie. On enchaîne des images funèbres puis sordides et pitoyables, avant de faire remonter des souvenirs plus lointains qui se réfèrent au vécu de notre jeune Omar.
Il voyait des psalmodieurs de Coran défiler en tête d'un enterrement. Il les suivait, persuadé que chaque pas accompli derrière les porteurs de bière réjouissait le défunt. On mourait beaucoup. Il ne manquait que ceux des convois qu'il ne rencontrait pas dans ses pérégrinations. Pour chacun de ces morts inconnus, il avait une pensée de sympathie. Il avait appris de longs passages de la Borda qu'il débitait pour le repos de leur âme.
Puis venaient des mendiants hâves et furtifs sous la pluie battante. D'autres images traversèrent encore son esprit. Aïni avait décidé plus d'un an plus tôt : "Apprends un métier ! Tu ne tireras rien de tes livres !." L'avant-dernier été courait alors sur sa fin, et les grandes vacances s'étaient achevées... Lui, n'avait pas dit non, et n'avait plus, de ce moment, remis les pieds en classe. Qu'il ait eu treize ans, que chaque heure passée à musarder fût du temps perdu, - elle ne le lui avait que trop rabâché. "J'ai bien usé de patience, après tout !"
Les oreilles sans arrêt échauffées par ses récriminations, il s'était engagé chez un épicier. Mais il commençait à peine à travailler, que le magasin était fermé par les autorités, et le marchand, son patron, jeté en prison.
"Ils prennent les petits trafiquants, et ménagent les gros...", s'était écriée Aïni.
Il avait bien été question de lui chercher une autre place ; cependant une année s'était passée, et il ne fichait toujours pas une rame. S'il y eut jamais galopin qui traînât dans les rues, franc de collier, insoucieux de l'heure, du temps qu'il faisait, des réprimandes de sa mère, c'était bien lui alors !
Il prêta l'oreille au remuement qui bouleversait la maison. Toute-puissante, la voix de la nuit grondait ; la pluie marchait. Au-delà de cette rumeur, le tonnerre craquait, et chaque fois que cet effondrement crevait le ciel, la vieille demeure tremblait. Il semblait que s'il tonnait une fois de plus, Dar Sbitar s'écroulerait.
Il eut soudain le sentiment que quelque chose guettait dans les ténèbres, il fut enveloppé d'inquiétude. Cela le fit penser à sa mère qui flairait le malheur partout et, grâce à une déchirante intuition, le déchiffrait en tout.
